Bonjour Mr Morvan. Pouvez-vous vous présenter pour les internautes de vampirisme.com
Je suis professeur émérite à l’Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris 3). Mes tâches administratives lourdes (14 années en poste comme recteur dans trois académies (Clermont-Ferrand, Amiens et Lyon) ne m’ont pas détourné de ma vocation d’angliciste. J’ai beaucoup publié sur des sujets de littérature et d’histoire des idées dans le monde anglophone. Au départ spécialiste du XVIIIe siècle, je ne me suis pas interdit des incursions vers d’autres tranches chronologiques. Ce livre en porte témoignage.
Après une anthologie consacrée au roman gothique parue en 2014, Frankenstein et autres romans gothiques, vous réitérez au sein de la Pléiade avec Dracula et autres écrits vampiriques. Pouvez-vous nous raconter la genèse de cette anthologie ?
 En travaillant sur le gothique, et notamment sur Frankenstein, je me suis rendu compte à quel point le thème vampirique y surgissait naturellement. J’ai ainsi voulu montrer, il y a quelques années, que le roman de Mary Shelley était responsable de ce que j’ai qualifié de « vampirisation du roman gothique ». Frankenstein, écrit au moment où Polidori compose son Vampire (1819), offre un véritable trait d’union entre l’écriture gothique et le genre vampirique, qui en est l’un des prolongements si j’ose dire consanguins. La mise en œuvre de mon recueil était donc toute naturelle.
En travaillant sur le gothique, et notamment sur Frankenstein, je me suis rendu compte à quel point le thème vampirique y surgissait naturellement. J’ai ainsi voulu montrer, il y a quelques années, que le roman de Mary Shelley était responsable de ce que j’ai qualifié de « vampirisation du roman gothique ». Frankenstein, écrit au moment où Polidori compose son Vampire (1819), offre un véritable trait d’union entre l’écriture gothique et le genre vampirique, qui en est l’un des prolongements si j’ose dire consanguins. La mise en œuvre de mon recueil était donc toute naturelle.
Votre préface met en exergue le corpus vampirique comme un prolongement de la littérature gothique, car il y puise de nombreux tropes. Pour autant, y a-t-il des différences notables entre les deux ? Par exemple, l’idée que le vampire resurgit en période de crise, si chère à Jean Marigny, me semble totalement absente des romans gothiques classiques ?
À mon sens, la littérature vampirique est assez rapidement devenue non pas un domaine autonome, mais une branche du récit gothique, dont la composante essentielle est le thème de la peur. Jean Marigny a raison : le vampire se fait plus d’autant plus mordant en période de crise. Mais quand on analyse les raisons de l’attrait paradoxal qu’exerce sur le public l’effet d’horreur, on se rend compte qu’il s’agit aussi de répondre à une carence profonde, ontologique. En l’occurrence, consciemment ou non, on ressent le besoin de réinsérer l’idée de mort dans une civilisation qui tend à l’occulter. Le roman gothique des origines, depuis le Château d’Otrante de Walpole (1764), se construit à partir d’une réaction d’insatisfaction devant un monde – celui qui procède des Lumières – rationalisé à l’excès, où tout est clair, analytiquement explicable et dédié à une foi dans le progrès qui néglige sans doute la face sombre de l’humanité et sa part de mystère. La peur est nécessaire à notre plein équilibre. C’est bien d’une crise spirituelle qu’il s’agit ici. Ainsi, même dans Dracula, qui, en 1897, baigne dans le modernisme (photos Kodak, machines à écrire portatives, transfusion sanguine entre humains, télégrammes), on sent les limites des avancées technologiques face aux mystères de l’humain. C’est ainsi, par exemple, que Van Helsing mêle en lui la scientificité la plus irréprochable et un penchant évident pour le surnaturel et le paranormal.
En intégrant à votre anthologie des auteurs comme Southey, Coleridge et Byron, vous appuyez la genèse du vampire littéraire par l’entremise de la poésie romantique. Comment expliquez-vous que le motif du vampire, jusque-là cantonné à la croyance populaire, a fini par trouver son chemin dans les vers des poètes de cette époque ? En d’autres termes, comment passe-t-on d’un De masticatione mortuorum in tumulis de Ranft, voire de la Dissertation de Calmet, à une Christabel ou un The Vampyre (John Stagg) ?
La poésie romantique de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe fait son miel des évolutions littéraires récentes, dont le roman gothique est le prolongement : intérêt pour le morbide, inquiétude face à l’industrialisation, valorisation de la sensibilité, de la solitude, de la transgression. Il s’opère alors une véritable confluence entre l’esprit du romantisme et ce que va incarner le personnage vampirique. Le vampire n’est pas seulement un prédateur ; c’est un être exceptionnel par son audace souveraine, son élitisme dédaigneux, son orgueil de solitaire. Le vampire – et ceci se voit très clairement chez Lord Ruthven, héros sanglant du roman de John William Polidori, Le Vampire – possède une aura faite de mystère et de hauteur qui le rapproche de bien des figures imaginées par les poètes romantiques. Et, pour commencer, de Byron lui-même.
Votre anthologie se focalise sur les auteurs anglais du XIXe siècle, ce dont vous vous justifiez dans le paratexte. Pour autant, peut-on s’attendre à ce qu’une anthologie complémentaire, regroupant les textes fondamentaux du corpus venus de France (Nodier, Gauthier…) ou d’Allemagne (Von Waschmann), finisse par voir le jour ?
Il fallait faire un choix. Le nôtre fut celui des aires culturelles, en l’espèce des îles Britanniques, véritable lieu de naissance des premières grandes œuvres vampiriques. D’autres aires, d’autres œuvres, méritent qu’on s’y arrête – et j’ai tenté de les évoquer dans l’Introduction de mon Dracula et autres écrits vampiriques. D’autres anthologies, moins centrées sur le monde anglophone, auront naturellement leur légitimité.
Au niveau des traductions, comment avez-vous procédé ? Vous expliquez de quelles versions des textes vous êtes parti (majoritairement des versions originales) mais comment travaillez-vous pour des textes qui ont déjà eu un large panel de traduction (je pense notamment à Dracula, mais aussi à Carmilla ou au Vampyre) ? Quels types d’ouvrages (s’il y en a) vous servent à appuyer vos décisions de traducteur ?
N’étant moi-même pas un vampire, je n’ai pas souhaiter me réfugier dans la méconnaissance dédaigneuse des autres traductions. Je les ai à l’occasion consultées, bien sûr, mais mon projet était tout de même de proposer une traduction originale, entièrement autonome, et soucieuse d’extrême fidélité au texte (ce qui est la moindre des choses) ainsi qu’à la chronologie. J’ai voulu systématiquement traduire chacun des textes du corpus en une langue qu’aurait comprise un lecteur de l’époque où le texte original avait été produit. Ce qui a impliqué une attention extrême au lexique. Il n’était pas question de traduire le «Fragment» de Byron, par exemple, en recourant à des termes qui n’étaient pas encore entrés dans notre langue en 1819, ou qui y possédaient un sens différent. De même j’ai voulu rendre les spécificités stylistiques et syntaxiques de chaque locuteur : dans Dracula, on ne peut rendre les propos de Van Helsing comme on rend ceux de son confrère le Dr Seward. Ni, dans Le Sang du vampire, faire comme si la truculente et vulgaire baronne Gobelli pouvait s’exprimer comme les personnages issus de la meilleure société.
Dans les textes retenus, le connaisseur a la surprise de découvrir Le Sang du Vampire de Florence Marryat. Comment avez-vous découvert ce texte ? Avez-vous des informations sur l’impact qu’il a pu avoir à l’époque de sa publication ?
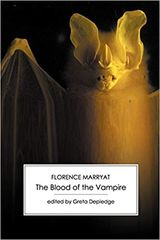 C’est comme angliciste que j’avais été amené à connaître ce superbe roman. Il n’était jamais paru en France (sans signaler qu’il s’agissait d’une traduction, la Gazette de Lausanne l’avait publié par épisodes en 1909). Il se trouve que Florence Marryat, auteur fort prolixe et très connue de son vivant (elle meurt en 1899), fait l’objet depuis quelques années d’un travail de réhabilitation en Grande-Bretagne comme aux États-Unis. L’accueil des contemporains, lorsque le roman parut en 1897 (même année que Dracula), fut très critique. On s’offusqua de l’immoralité de certains des personnages mis en scène par Florence Marryat, sans voir que cette œuvre posait en termes très poignants – au-delà d’une apparence de comédie de mœurs un peu boulevardière – le problème du Mal et de son inévitabilité. Hannah Arendt aurait ici aussi parlé de banalité du Mal.
C’est comme angliciste que j’avais été amené à connaître ce superbe roman. Il n’était jamais paru en France (sans signaler qu’il s’agissait d’une traduction, la Gazette de Lausanne l’avait publié par épisodes en 1909). Il se trouve que Florence Marryat, auteur fort prolixe et très connue de son vivant (elle meurt en 1899), fait l’objet depuis quelques années d’un travail de réhabilitation en Grande-Bretagne comme aux États-Unis. L’accueil des contemporains, lorsque le roman parut en 1897 (même année que Dracula), fut très critique. On s’offusqua de l’immoralité de certains des personnages mis en scène par Florence Marryat, sans voir que cette œuvre posait en termes très poignants – au-delà d’une apparence de comédie de mœurs un peu boulevardière – le problème du Mal et de son inévitabilité. Hannah Arendt aurait ici aussi parlé de banalité du Mal.
Le vampire est une figure qui n’a eu de cesse d’être réactualisée en littérature depuis sa naissance. Ces 40 dernières années ont ainsi vu de nombreuses variations paraître, dans une dynamique qui semble avoir été initiée par le Entretien avec un Vampire d’Anne Rice. Retrouvez-vous certaines caractéristiques des vampires du XIXe siècle dans les œuvres modernes sur le sujet. Beaucoup voient notamment dans l’avènement du vampire en tant que figure de romance une réactualisation de la romance gothique chère à Ann Radcliffe ?
D’un point de vue structurel, ce qui caractérise le personnage vampirique, c’est la permanence (ou en tout cas une grande stabilité) de sa typologie. Le vampirisme littéraire (ou cinématographique) est un genre extrêmement codé, répondant à des traits canoniques. On peut bien sûr se livrer à des variations (parfois souriantes) sur ce thème – et le public, en ce domaine, a été bien servi. Mais l’essentiel demeure par-delà les avatars – et notamment l’alliance mortifère de la séduction et de la prédation.


