Le vampire : une figure codifiée
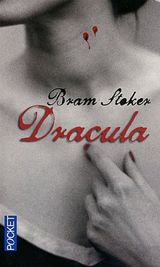 Jusqu’aux années 1970, les vampires sont avant tout des créatures dont les modèles restent le Lord Ruthven du Vampire de John Polidori (1819), la Carmilla de Sheridan Le Fanu (1872) et le Dracula de Bram Stoker (1897) : des créatures subversives, représentations canoniques du Mal. Dans ces textes fondateurs, le vampire apparaît en effet comme une représentation de la tentation et de la perversion, pour qui succombent les plus faibles. Des créatures qui semblent par ailleurs mues par une obsession unique : boire du sang (tabou moral aussi bien que religieux) pour assurer leur survie.
Jusqu’aux années 1970, les vampires sont avant tout des créatures dont les modèles restent le Lord Ruthven du Vampire de John Polidori (1819), la Carmilla de Sheridan Le Fanu (1872) et le Dracula de Bram Stoker (1897) : des créatures subversives, représentations canoniques du Mal. Dans ces textes fondateurs, le vampire apparaît en effet comme une représentation de la tentation et de la perversion, pour qui succombent les plus faibles. Des créatures qui semblent par ailleurs mues par une obsession unique : boire du sang (tabou moral aussi bien que religieux) pour assurer leur survie.
La littérature, puis le cinéma, ont lourdement contribué à façonner cette idée d’une créature maléfique et manichéenne, qui appartient au monde des idées reçues. Le vampire est jugé avant même de pouvoir se défendre, tant ce qu’il représente est en contradiction avec la société. Très vite, il passe de figure de proue de la littérature gothique à porte-étendard de la littérature horrifique, ce qui empêche toute tentative de contraste. Difficile d’apparaître comme quelqu’un de sympathique quand on a les yeux injectés de sang et des canines démesurées, d’où coule du sang frais… D’autant que dès ses débuts, le vampire est une créature quasi muette. Chez Bram Stoker, c’est le seul protagoniste qui ne prend jamais directement la parole, mais dont on rapporte les propos. Ce dont le cinéma se rappellera dès les premières adaptations marquantes, qu’il s’agisse du Nosferatu de Murnau, du Dracula de Browning ou du Cauchemar de Dracula de Fisher (où Christopher Lee n’a aucune ligne de dialogue).
 Au XXe siècle, on note cependant deux tentatives qui font figure d’exception. Les nouvelles « Dans ma solitude » de Henry Kuttner (1933) et « Frères de la chauve-souris » de Robert Bloch (1944) présentent en effet un vampire nostalgique de sa vie humaine passée, voire refusant la malédiction dont il est atteint. Un vampire qui s’exprime par ailleurs lui-même pour dire son mal-être. Mais ces deux nouvelles restent des cas à part (même si on peut aussi pointer le plus ancien Je suis d’ailleurs de Lovecraft (1926), qui explorait quelques idées similaires). Il faudra en effet attendre la fin des conflits mondiaux, et de la crise économique, qui ont lourdement joué la carte de l’étranger/l’autre faisant figure d’ennemi (voire de bouc-émissaire), pour que les auteurs et réalisateurs envisagent de donner une autre vocation au vampire que celle de représenter le mal à l’état pur. À partir de là, les auteurs ont tout loisir de faire symboliser autre chose au vampire. Voire d’inverser les rôles, dans un roman comme Je suis une légende de Matheson (1958) où c’est l’être humain qui devient le solitaire, proie des vampires qui sont devenus l’espèce dominante.
Au XXe siècle, on note cependant deux tentatives qui font figure d’exception. Les nouvelles « Dans ma solitude » de Henry Kuttner (1933) et « Frères de la chauve-souris » de Robert Bloch (1944) présentent en effet un vampire nostalgique de sa vie humaine passée, voire refusant la malédiction dont il est atteint. Un vampire qui s’exprime par ailleurs lui-même pour dire son mal-être. Mais ces deux nouvelles restent des cas à part (même si on peut aussi pointer le plus ancien Je suis d’ailleurs de Lovecraft (1926), qui explorait quelques idées similaires). Il faudra en effet attendre la fin des conflits mondiaux, et de la crise économique, qui ont lourdement joué la carte de l’étranger/l’autre faisant figure d’ennemi (voire de bouc-émissaire), pour que les auteurs et réalisateurs envisagent de donner une autre vocation au vampire que celle de représenter le mal à l’état pur. À partir de là, les auteurs ont tout loisir de faire symboliser autre chose au vampire. Voire d’inverser les rôles, dans un roman comme Je suis une légende de Matheson (1958) où c’est l’être humain qui devient le solitaire, proie des vampires qui sont devenus l’espèce dominante.
Un entretien qui va tout changer
 Jusqu’en 1975, les codes cinématographiques (dont la littérature va elle-même s’inspirer) figent la représentation du vampire. De nouveaux codes ont été ajouté au fil du temps, devenant dès lors un cahier des charges avec lequel les auteurs doivent composer. Le Flower Power des années 60 ayant fait feu de tout bois, arrive cependant un temps où réalisateurs et romanciers décident de rompre avec le manichéisme d’antan, et de s’intéresser à des figures plus ambiguës, à commencer par Le Parrain (roman de Mario Puzzo adapté par Francis Ford Coppola en 1972), qui propose une immersion dans le fonctionnement de la mafia italienne, du point de vue non pas de la police mais des pontes de la pègre. En 1976, Anne Rice, avec son Entretien avec un vampire, est totalement dans cette lignée. En permettant au vampire (Louis, puis Lestat) de prendre la parole, elle permet aux buveurs de sang de devenir des alter ego du lecteur, qui va pouvoir partager les tourments, peines et regrets de ces derniers, par le jeu de l’introspection. On passe en effet de la multitude de narrateurs d’un Dracula au « je » unique du premier roman des Chroniques des vampires. Dès lors, la réflexion peut porter sur la manière dont le vampire parvient (ou pas) à concilier ses besoins et son éthique, héritée en partie de ses années en tant que mortel. La manière dont le vampire propage sa malédiction, et l’obsession pour les humains de tuer les vampires passent au second plan.
Jusqu’en 1975, les codes cinématographiques (dont la littérature va elle-même s’inspirer) figent la représentation du vampire. De nouveaux codes ont été ajouté au fil du temps, devenant dès lors un cahier des charges avec lequel les auteurs doivent composer. Le Flower Power des années 60 ayant fait feu de tout bois, arrive cependant un temps où réalisateurs et romanciers décident de rompre avec le manichéisme d’antan, et de s’intéresser à des figures plus ambiguës, à commencer par Le Parrain (roman de Mario Puzzo adapté par Francis Ford Coppola en 1972), qui propose une immersion dans le fonctionnement de la mafia italienne, du point de vue non pas de la police mais des pontes de la pègre. En 1976, Anne Rice, avec son Entretien avec un vampire, est totalement dans cette lignée. En permettant au vampire (Louis, puis Lestat) de prendre la parole, elle permet aux buveurs de sang de devenir des alter ego du lecteur, qui va pouvoir partager les tourments, peines et regrets de ces derniers, par le jeu de l’introspection. On passe en effet de la multitude de narrateurs d’un Dracula au « je » unique du premier roman des Chroniques des vampires. Dès lors, la réflexion peut porter sur la manière dont le vampire parvient (ou pas) à concilier ses besoins et son éthique, héritée en partie de ses années en tant que mortel. La manière dont le vampire propage sa malédiction, et l’obsession pour les humains de tuer les vampires passent au second plan.
Chez Anne Rice, la figure du vampire perd son fondement manichéen (le vampire n’est plus de facto considéré comme une créature mauvaise), permettant de s’intéresser à sa psychologie. L’auteur est en effet une des premières qui va mettre en scène un questionnement sur l’existence et l’origine des vampires, ce qui permet de remettre en cause certains des codes établis, ou de les faire évoluer. Ce faisant, elle donne naissance à une nouvelle forme de vampire, et va même jusqu’à mettre en scène la rencontre entre ses vampires modernes et les vampires qui les ont précédés. Louis et Claudia, dans leur périple en Europe, découvriront ainsi d’autres buveurs de sang bien moins civilisés, pour ne pas dire submergés par leurs instincts.
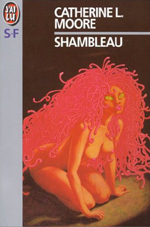 Anne Rice est également une des premières auteurs femmes à se pencher au long cours (sous la forme d’une série) sur le berceau des vampires, et va à ce titre servir de guide à de nombreux auteurs qui vont lui succéder. Jusque-là, en effet, rares sont les romancières à avoir contribué à la cause du vampire littéraire. On dénombre en effet essentiellement des textes de nouvellistes sur le sujet, parmi lesquels le Good Lady Ducayne de Mary Elizabeth Braddon (1896), ou le recueil Shambleau de Catherine Moore (dont chaque nouvelle offre une vision science-fictive de la thématique vampirique). Mais aucune n’est parvenue à faire école.
Anne Rice est également une des premières auteurs femmes à se pencher au long cours (sous la forme d’une série) sur le berceau des vampires, et va à ce titre servir de guide à de nombreux auteurs qui vont lui succéder. Jusque-là, en effet, rares sont les romancières à avoir contribué à la cause du vampire littéraire. On dénombre en effet essentiellement des textes de nouvellistes sur le sujet, parmi lesquels le Good Lady Ducayne de Mary Elizabeth Braddon (1896), ou le recueil Shambleau de Catherine Moore (dont chaque nouvelle offre une vision science-fictive de la thématique vampirique). Mais aucune n’est parvenue à faire école.
Dans les pas d’Anne Rice
 Parler uniquement d’Anne Rice pour ce qui est de ce tournant vers le vampire moderne serait oublier qu’un romancier l’a précédé d’un an. En effet, en 1975, Fred Saberhagen sort le premier tome de ses Chroniques de Dracula. S’il ne donne pas vie à une nouvelle galerie de vampires emblématiques, il va pour autant donner la parole au comte de Bram Stoker, lui offrant la possibilité, avec Les Confessions de Dracula, de raconter sa version des faits. Si tous les opus de la série ne sont pas d’une qualité homogène (la rencontre entre Dracula et Sherlock Holmes étant un vrai raté), elle va avoir une influence non négligeable sur les prochaines variations autour du mythe. La romance entre Mina et Dracula, que Coppola met en scène dans son adaptation du roman, pourrait en effet découler du travail du romancier américain. D’autant que le romancier a contribué au scénario du film. Avant même qu’Anne Rice donne un nouveau coup de jeune au mythe, Saberhagen avait donc déjà pensé à réécrire l’histoire du plus célèbre vampire de fiction.
Parler uniquement d’Anne Rice pour ce qui est de ce tournant vers le vampire moderne serait oublier qu’un romancier l’a précédé d’un an. En effet, en 1975, Fred Saberhagen sort le premier tome de ses Chroniques de Dracula. S’il ne donne pas vie à une nouvelle galerie de vampires emblématiques, il va pour autant donner la parole au comte de Bram Stoker, lui offrant la possibilité, avec Les Confessions de Dracula, de raconter sa version des faits. Si tous les opus de la série ne sont pas d’une qualité homogène (la rencontre entre Dracula et Sherlock Holmes étant un vrai raté), elle va avoir une influence non négligeable sur les prochaines variations autour du mythe. La romance entre Mina et Dracula, que Coppola met en scène dans son adaptation du roman, pourrait en effet découler du travail du romancier américain. D’autant que le romancier a contribué au scénario du film. Avant même qu’Anne Rice donne un nouveau coup de jeune au mythe, Saberhagen avait donc déjà pensé à réécrire l’histoire du plus célèbre vampire de fiction.
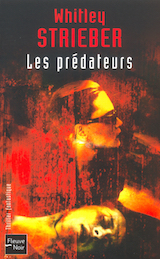 À la suite de la romancière de la Nouvelle Orléans, plusieurs auteurs vont donner un nouveau souffle aux enfants de la nuit. À commencer par Whitley Strieber qui publie en 1981 le premier opus des Prédateurs, une série mettant en scène une vampire en quête de compréhension face à la malédiction qui pèse sur ceux à qui elle offre le don d’immortalité. Comment ne pas voir, dans le premier tome de la série, un parallèle entre la relation qui unit Myriam et Sarah, et celle qui unit Louis et Lestat. Des relations homosexuelles dont les protagonistes sont complémentaires, mais pour autant vouées à l’échec. Car la possibilité d’une relation épanouie entre un être humain (ou un vampire encore imprégné de sa vie humaine) est encore inenvisageable. S.P. Somtow avec la trilogie Timmy Valentine, qu’il entame dès 1984 avec Vampire Junction, explore également des idées ébauchées par Anne Rice. Il met en effet en scène un enfant vampire (et rock star) faisant appel à une psychanalyste pour tenter de comprendre ce qu’il est et trouver un équilibre. L’exploration des affects du vampire se poursuit donc. Après lui avoir offert le droit à la parole, on cherche à explorer les méandres de son esprit.
À la suite de la romancière de la Nouvelle Orléans, plusieurs auteurs vont donner un nouveau souffle aux enfants de la nuit. À commencer par Whitley Strieber qui publie en 1981 le premier opus des Prédateurs, une série mettant en scène une vampire en quête de compréhension face à la malédiction qui pèse sur ceux à qui elle offre le don d’immortalité. Comment ne pas voir, dans le premier tome de la série, un parallèle entre la relation qui unit Myriam et Sarah, et celle qui unit Louis et Lestat. Des relations homosexuelles dont les protagonistes sont complémentaires, mais pour autant vouées à l’échec. Car la possibilité d’une relation épanouie entre un être humain (ou un vampire encore imprégné de sa vie humaine) est encore inenvisageable. S.P. Somtow avec la trilogie Timmy Valentine, qu’il entame dès 1984 avec Vampire Junction, explore également des idées ébauchées par Anne Rice. Il met en effet en scène un enfant vampire (et rock star) faisant appel à une psychanalyste pour tenter de comprendre ce qu’il est et trouver un équilibre. L’exploration des affects du vampire se poursuit donc. Après lui avoir offert le droit à la parole, on cherche à explorer les méandres de son esprit.
Ces différentes séries poussent la révolution initiée par Anne Rice, en amenant un peu plus loin l’idée d’une ouverture du vampire sur le monde. Le temps est venu de se pencher sur les tourments du vampire, sa peur de vivre seul (alors que jusque là il est une créature solitaire), le besoin de comprendre ce qu’il est (entité maléfique ou jeu de la nature). Le vampire devient un être pensant, et plus un être actant. L’une des preuves en est l’évolution de sa relation au sang. Anne Rice est en effet la première à mettre en scène des vampires ayant recours au sang d’animaux.

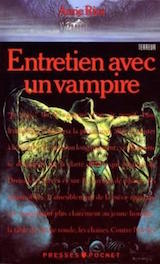

J’aime beaucoup ce premier article sur l’évolution de nos dentus préférés. Il permet bien de comprendre le tournant que représente Rice.
Ceci dit, il aurait peut-être été judicieux de revenir sur ce qu’était le vampire avant cette première modification. C’est abordé mais peut-être pas assez bien défini dans un chapitre. Un public néophyte pourrait avoir du mal à saisir l’image du « vieux » vampire.
J’aime beaucoup tous les références que tu cites, aussi bien nouvelles que romans (et sagas)
En tout cas, hâte d’avoir les deux suites 🙂
Bravo !
Rice reporte sur la figure du vampire nos propres tourments existentiels.
Et elle en défigure d’autant l’être démoniaque et maléfique de la mythologie d’europe centrale, pour en faire un personnage d’une faiblesse absolument pathétique.
Le vampire ne fait plus peur, il inspire la pitié et la compassion.
Pouah !
C’est vraiment pathétique…
Depuis un peu plus de 40 ans maintenant, le vampire à troqué tout à coup sa longue cape noire contre un costume rose bonbon de chez Monoprix et suce du sang de lapin.
Mais s’agit-il toujours d’un vampire ?
Il y a quelques jours, j’ai relu (avec toujours autant d’intérêt) l’ouvrage de adrien Cremene « Mythologie du vampire en Roumanie » et peu de temps auparavant, celui de claude Lecouteux « Histoire des Vampires, autopsie d’un mythe ».
Je cite juste ces deux bouquins, rien de plus…
Il serait fort utile pour de nombreux auteurs de romans actuels de se replonger (ou de prendre simplement connaissance) des fondements de ce qui constitue la genèse du vampirisme.
Histoire de connaitre un tantinet son sujet, pour rester un minimum dans les clous.
Encore une fois, la « Collection Arlequin » très peu pour moi.
Donc, je passe mon tour.