Bonjour. Pouvez-vous vous présenter pour les internautes de Vampirisme.com ?
Bonjour. Je m’appelle Jacques Finné. Je suis né à Bruxelles, le 29 mars 1944. J’ai fait toute mes études dans cette ville, jusqu’à ma licence. J’ai enseigné pendant quelque quarante ans à la faculté de traduction de Zurich – pendant ces années, j’ai passé les épreuves du doctorat dans ma ville natale, à l’ULB, comme pour un dernier hommage. Depuis l’école primaire, je me suis plu à lire les contes de fées, de tous pays. Puis, comme ma bibliothèque communale n’était pas trop riche dans ce domaine, une adorable préposée m’a aiguillé vers le fantastique auquel je suis resté fidèle toute ma vie.
Vous venez de sortir coup sur coup aux éditions Terre de Brume une anthologie et un essai consacrés à la figure de la goule. Après lui avoir déjà attribué une place dans Trois saigneurs de la nuit, pourquoi y revenir une nouvelle fois ?
Un beau jour (oui : vraiment beau), j’ai proposé aux Nouvelles Editions Oswald un projet d’anthologie sur ce thème : j’estimais que la goule, être fantastique, n’occupait pas vraiment sa place dans la littérature. La première réaction a renforcé mon idée de « thème fantastique exilé » : Mme et M. Oswald estimaient que « cela ne se vendrait pas ». En fin de compte, nous sommes tombés d’accord sur un panaché : goules, loups-garous et vampires.

Comme la critique a apprécié les anthologies, et surtout, parfois, les étranges créatures si peu connues, j’ai entrepris quelques petites recherches à leur sujet, sans avoir grand-projet en tête. Ma curiosité s’est accrue quand j’ai découvert qu’il n’existait aucune anthologie sur ce thème (celles de Bill Pronzini et de Peter Haining sont trompeuses) et, pire encore, que personne ne lui avait consacré une étude complète, dans aucune langue. J’ai alors résolu de « boucher les trous ». J’ai donc concocté une anthologie de goules et, en même temps, je faisais des recherches sur celles-ci. Terre de Brume a accepté les deux projets – et le vide est comblé. Pas tout à fait, cependant. Dans mes tiroirs dort La Grande Anthologie de la goule qui rassemble tous les récits concernant cette demoiselle si particulière : le volume prendrait quelque 1 000 pages – un « Omnibus » ou un « Bouquin ». Tous ? Mais oui : dans L’Univers, j’écris que la goule est en train de disparaître de l’hôtel du fantastique, parce que le zombi la dévore avec de plus en plus de gourmandise, comme un affamé. À ma grande tristesse, le projet mourra sans doute comme la goule : un des responsables de « Omnibus » m’a avoué que le fantastique « canonique » perdait du terrain, chez le lecteur ; la preuve : ils ont abandonné eux-mêmes le projet (excitant, mais titanesque) de publier les œuvres complètes de Jean Ray !
Votre essai montre que la goule a été de nombreuses fois placée sous le patronage (pour ne pas dire raccrochée) au vampire (les textes des Milles et une Nuits souvent repris dans les anthologies sur le sujet, La nouvelle de Hoffmann retitrée de manière erronée). Comment expliquez-vous cela ?
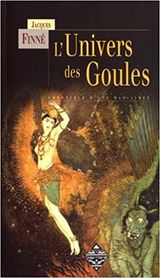 Dans L’Univers des goules, je souligne la mauvaise presse de la goule et j’essaie d’en expliquer la cause. Il est clair que l’on n’introduit pas la créature de bon gré. Elle est plus répugnante, par exemple, qu’un vampire – qui se contente de suçoter le sang des humains. C’est pourquoi on l’évite – et pire, on ne lui accorde qu’un rôle de second plan, à de rarissimes exceptions près : je pense au superbe Ghoul, de Brian Keene, que je rêve de traduire. On l’évite au point, parfois, de ne pas la nommer ou, pire, de remplacer le mot maudit par un autre – d’où le glissement des récits de goules vers les récits de vampires. Ainsi, la nouvelle de Hoffmann a-t-elle subi l’enfer vampirique pendant des décennies, alors que, de toute évidence, Aurélie est une goule – le titre original (Hyänen ») en fait foi, puisque la goule pourrait bien être la transposition littéraire de cette sale bête. On trouve pire. Frank Belknap Long a rédigé une superbe histoire de goule : « Cela va être votre tour ». Un brave homme, goûteur dans un grand restaurant, montre un sens gustatif des plus étranges : par exemple, il décrète « délicieuse » une viande pourrie qui a envoyé les autres goûteurs au service des urgences de l’hôpital le plus proche. À mesure que le récit progresse, le lecteur comprend, avec de plus en plus de certitude, que le protagoniste est une goule. Il a raison : en fin de récit, l’infortuné se retrouve devant Lucifer qui l’oblige à dire qui il est. Et le pauvret de murmurer : « I am… a ghoul. » Les lecteurs français ont droit à : « Je suis… un vampire. » Pourquoi cette gaffe – elle brise en mille morceaux toute la texture délicate du texte qui sue le thème de la goule à chaque page ? Erreur du traducteur ? Même le plus demeuré ne pourrait confondre les deux mots ! En prime, c’est l’admirable Jacques Parsons qui s’est chargé de la version française – un vieux routier de la littérature fantastique. Il n’aurait pu commettre pareille bourde. Il ne reste qu’une solution : l’éditeur n’a pas accepté le mot et a imposé le changement pour des raisons de (dé)goût personnel ou des motifs commerciaux.
Dans L’Univers des goules, je souligne la mauvaise presse de la goule et j’essaie d’en expliquer la cause. Il est clair que l’on n’introduit pas la créature de bon gré. Elle est plus répugnante, par exemple, qu’un vampire – qui se contente de suçoter le sang des humains. C’est pourquoi on l’évite – et pire, on ne lui accorde qu’un rôle de second plan, à de rarissimes exceptions près : je pense au superbe Ghoul, de Brian Keene, que je rêve de traduire. On l’évite au point, parfois, de ne pas la nommer ou, pire, de remplacer le mot maudit par un autre – d’où le glissement des récits de goules vers les récits de vampires. Ainsi, la nouvelle de Hoffmann a-t-elle subi l’enfer vampirique pendant des décennies, alors que, de toute évidence, Aurélie est une goule – le titre original (Hyänen ») en fait foi, puisque la goule pourrait bien être la transposition littéraire de cette sale bête. On trouve pire. Frank Belknap Long a rédigé une superbe histoire de goule : « Cela va être votre tour ». Un brave homme, goûteur dans un grand restaurant, montre un sens gustatif des plus étranges : par exemple, il décrète « délicieuse » une viande pourrie qui a envoyé les autres goûteurs au service des urgences de l’hôpital le plus proche. À mesure que le récit progresse, le lecteur comprend, avec de plus en plus de certitude, que le protagoniste est une goule. Il a raison : en fin de récit, l’infortuné se retrouve devant Lucifer qui l’oblige à dire qui il est. Et le pauvret de murmurer : « I am… a ghoul. » Les lecteurs français ont droit à : « Je suis… un vampire. » Pourquoi cette gaffe – elle brise en mille morceaux toute la texture délicate du texte qui sue le thème de la goule à chaque page ? Erreur du traducteur ? Même le plus demeuré ne pourrait confondre les deux mots ! En prime, c’est l’admirable Jacques Parsons qui s’est chargé de la version française – un vieux routier de la littérature fantastique. Il n’aurait pu commettre pareille bourde. Il ne reste qu’une solution : l’éditeur n’a pas accepté le mot et a imposé le changement pour des raisons de (dé)goût personnel ou des motifs commerciaux.
Dans l’anthologie, on découvrait un texte d’un auteur inconnu, S. Brillioth, texte qui s’avère être au final l’un des plus réussis sur le sujet, car contemporain tout en respectant la figure classique de la goule. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet auteur ?
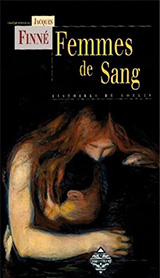 Concernant Brillioth, je ne peux rien ajouter aux quelques pages de présentation de sa nouvelle, dans Femmes de sang. Il s’agit d’un Américain (pardon : d’un Bostonien !) que j’ai connu à l’ULB. Un goût commun pour la littérature fantastique nous a rapprochés. Il écrivait, je traduisais – et j’ai traduit ses textes (une demi-douzaine de nouvelles et une novella) pour lesquels j’ai eu le coup de foudre. Il traduisait lui aussi : il avait apprécié Le Pays sans étoiles, de Pierre Very, et rêvait de le publier en Amérique. En raison d’une obscure histoire de famille, il a dû regagner son Boston. Depuis, c’est le vide. Les lettres que je lui ai écrites me sont revenues avec la mention « Inconnu à l’adresse ». Il ne m’a jamais donné signe de vie non plus. Ses œuvres semblent l’objet d’une singulière malchance, en français ou en espagnol. Quant à sa nouvelle de goule, elle entre dans le courant des auteurs qui ne peuvent dissocier goule et Orient des Mille et une Nuits. Toutefois, Brillioth est tombé dans le piège des auteurs contemporains qui ont abordé ce thème : ses goules ont annexé des caractéristiques vampiriques – par exemples, l’absence de reflet dans le miroir et la faculté de se transformer en poussière, pour pouvoir se glisser par le plus petit interstice. Je suis heureux qu’« Émina, Zibeddé et l’aubergiste » trouve grâce à vos yeux. J’espère beaucoup pour sa novella (Vienne la neige), pour le moment entre les mains des éditions Terre de Brume.
Concernant Brillioth, je ne peux rien ajouter aux quelques pages de présentation de sa nouvelle, dans Femmes de sang. Il s’agit d’un Américain (pardon : d’un Bostonien !) que j’ai connu à l’ULB. Un goût commun pour la littérature fantastique nous a rapprochés. Il écrivait, je traduisais – et j’ai traduit ses textes (une demi-douzaine de nouvelles et une novella) pour lesquels j’ai eu le coup de foudre. Il traduisait lui aussi : il avait apprécié Le Pays sans étoiles, de Pierre Very, et rêvait de le publier en Amérique. En raison d’une obscure histoire de famille, il a dû regagner son Boston. Depuis, c’est le vide. Les lettres que je lui ai écrites me sont revenues avec la mention « Inconnu à l’adresse ». Il ne m’a jamais donné signe de vie non plus. Ses œuvres semblent l’objet d’une singulière malchance, en français ou en espagnol. Quant à sa nouvelle de goule, elle entre dans le courant des auteurs qui ne peuvent dissocier goule et Orient des Mille et une Nuits. Toutefois, Brillioth est tombé dans le piège des auteurs contemporains qui ont abordé ce thème : ses goules ont annexé des caractéristiques vampiriques – par exemples, l’absence de reflet dans le miroir et la faculté de se transformer en poussière, pour pouvoir se glisser par le plus petit interstice. Je suis heureux qu’« Émina, Zibeddé et l’aubergiste » trouve grâce à vos yeux. J’espère beaucoup pour sa novella (Vienne la neige), pour le moment entre les mains des éditions Terre de Brume.
Pour revenir sur votre carrière de traducteur et essayiste, votre intérêt pour les créatures de la nuit ne date pas d’hier. Mais si je calcule bien, votre première traduction d’importance sur le sujet a été le Dracula de Bram Stoker. Comment aborde-t-on la traduction d’un roman aussi emblématique et important que celui-ci ?
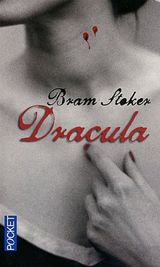 On l’aborde avec le sentiment que ressentirait la fourmi devant la pyramide de grains qu’elle doit transporter. Dracula suscite la peur – également chez les misérables qui doivent le traduire. Une peur à plusieurs degrés. Devant le volume, d’abord – le « tapuscrit » atteignait presque les mille feuillets. Devant la diversité de styles, ensuite : le roman est en « narration explosée », c’est-à-dire qu’il se compose de textes disparates rédigés par des mains différentes. À chacun sa manière de s’exprimer. Le style mène à l’absence de style : Van Helsing baragouine un anglais très personnel, très flamand, en fait. Je me suis demandé si je devais rendre pareille particularité par un français de cuisine, et j’ai renoncé, par respect pour le lecteur. Je me suis contenté de laisser une note pour signaler la particularité folklorique du chasseur de vampires, puis je l’ai laissé s’exprimer en une langue convenable. Jacques Sirgent, dans sa traduction toute récente, a choisi l’autre attitude. Aux lecteurs de trancher pour savoir qui a pris la bonne décision.
On l’aborde avec le sentiment que ressentirait la fourmi devant la pyramide de grains qu’elle doit transporter. Dracula suscite la peur – également chez les misérables qui doivent le traduire. Une peur à plusieurs degrés. Devant le volume, d’abord – le « tapuscrit » atteignait presque les mille feuillets. Devant la diversité de styles, ensuite : le roman est en « narration explosée », c’est-à-dire qu’il se compose de textes disparates rédigés par des mains différentes. À chacun sa manière de s’exprimer. Le style mène à l’absence de style : Van Helsing baragouine un anglais très personnel, très flamand, en fait. Je me suis demandé si je devais rendre pareille particularité par un français de cuisine, et j’ai renoncé, par respect pour le lecteur. Je me suis contenté de laisser une note pour signaler la particularité folklorique du chasseur de vampires, puis je l’ai laissé s’exprimer en une langue convenable. Jacques Sirgent, dans sa traduction toute récente, a choisi l’autre attitude. Aux lecteurs de trancher pour savoir qui a pris la bonne décision.
On vous doit également les traductions de La chambre dans la tour, de car la vie est dans le sang, du Vampire de la sainte inquisition, sans compter votre travail sur Trois saigneurs de la nuit et Les femmes vampires. Comment expliquez-vous cette présence forte du vampire dans votre travail ?
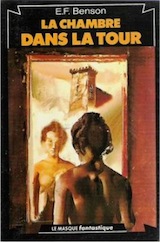 On me dit misanthrope. J’accepte volontiers l’étiquette en précisant que je le suis aussi dans mes travaux. Pour être concret : je n’aime pas fouiner dans un domaine tellement encombré qu’il ressemble à un grand magasin, une semaine avant Noël. J’ai aimé le fantastique dès ma jeunesse. Je m’y suis davantage attaché en constatant que bien peu de chercheurs avaient publié sur le sujet. Dans les années 60, je connaissais les essais de Roger Caillois, de Max Milner et de Pierre-George Castex. Après, il fallait chercher. Même pendant mes études universitaires, avouer que l’on s’occupait de littérature fantastique revenait à passer pour un doux cinglé – chez mes camarades comme chez la plupart de mes professeurs. Puis, petit à petit, le fantastique est devenu à la mode. Il a multiplié les études jusqu’à et au-delà de la saturation. Je me suis senti mal à l’aise dans cette cohue. Une fois passée ma thèse de doctorat (sur la littérature fantastique, bien entendu), une fois publié le squelette de celle-ci, j’ai cherché un marché plus calme, et j’ai jeté mon dévolu sur les vampires, peu fréquentés à l’époque – en français, à part l’essai pionnier de Tony (Antoine) Faivre, le vampire était encore terrain explorable. Soyons tout de même sincères : le thème m’attirait depuis longtemps déjà. Pour être plus précis, depuis 1960, quand j’ai eu admiré le film de Vadim, basé sur la Carmilla, de J. S. Le Fanu (que j’ai lu dans la foulée, de même que la grosse anthologie publiée après la sortie du film). La cause de ce « coup de foudre » est évidente : qui résisterait longtemps à Annette Stroyberg ?
On me dit misanthrope. J’accepte volontiers l’étiquette en précisant que je le suis aussi dans mes travaux. Pour être concret : je n’aime pas fouiner dans un domaine tellement encombré qu’il ressemble à un grand magasin, une semaine avant Noël. J’ai aimé le fantastique dès ma jeunesse. Je m’y suis davantage attaché en constatant que bien peu de chercheurs avaient publié sur le sujet. Dans les années 60, je connaissais les essais de Roger Caillois, de Max Milner et de Pierre-George Castex. Après, il fallait chercher. Même pendant mes études universitaires, avouer que l’on s’occupait de littérature fantastique revenait à passer pour un doux cinglé – chez mes camarades comme chez la plupart de mes professeurs. Puis, petit à petit, le fantastique est devenu à la mode. Il a multiplié les études jusqu’à et au-delà de la saturation. Je me suis senti mal à l’aise dans cette cohue. Une fois passée ma thèse de doctorat (sur la littérature fantastique, bien entendu), une fois publié le squelette de celle-ci, j’ai cherché un marché plus calme, et j’ai jeté mon dévolu sur les vampires, peu fréquentés à l’époque – en français, à part l’essai pionnier de Tony (Antoine) Faivre, le vampire était encore terrain explorable. Soyons tout de même sincères : le thème m’attirait depuis longtemps déjà. Pour être plus précis, depuis 1960, quand j’ai eu admiré le film de Vadim, basé sur la Carmilla, de J. S. Le Fanu (que j’ai lu dans la foulée, de même que la grosse anthologie publiée après la sortie du film). La cause de ce « coup de foudre » est évidente : qui résisterait longtemps à Annette Stroyberg ?
Les femmes vampires est une anthologie qui met davantage en lumière des auteurs féminins que masculins. Est-ce un hasard, compte tenu du titre du livre ? Y a-t-il une double lecture possible du titre ?
 L’affirmation me semble bien hardie : sur cinq nouvelles, ces dames en ont rédigé deux. Il n’y a aucune double lecture, mais une simple question de gros sous. À l’origine, Jean Marigny, mon collègue (et néanmoins ami) avait eu l’idée de rassembler une grosse anthologie centrée sur des femmes vampires – il en existe plus qu’on ne le croit à première vue. Nous avons travaillé d’arrache-pied, de part et d’autre d’une bouteille de sancerre, et avons proposé le pavé à une maison spécialisée dans les publications de cette envergure. Elle n’a pas retenu le projet, considéré comme « trop onéreux pour une vente problématique ». En fin de compte, les Éditions José Corti ont accepté de publier une (petite) partie de l’anthologie. Comme l’éditeur désirait sortir l’ouvrage dans la collection « Domaine romantique », il n’a retenu que les cinq nouvelles (sur les vingt qui formaient le projet de base) écrites pendant le XIXe siècle. L’anthologie complète dort toujours dans nos tiroirs.
L’affirmation me semble bien hardie : sur cinq nouvelles, ces dames en ont rédigé deux. Il n’y a aucune double lecture, mais une simple question de gros sous. À l’origine, Jean Marigny, mon collègue (et néanmoins ami) avait eu l’idée de rassembler une grosse anthologie centrée sur des femmes vampires – il en existe plus qu’on ne le croit à première vue. Nous avons travaillé d’arrache-pied, de part et d’autre d’une bouteille de sancerre, et avons proposé le pavé à une maison spécialisée dans les publications de cette envergure. Elle n’a pas retenu le projet, considéré comme « trop onéreux pour une vente problématique ». En fin de compte, les Éditions José Corti ont accepté de publier une (petite) partie de l’anthologie. Comme l’éditeur désirait sortir l’ouvrage dans la collection « Domaine romantique », il n’a retenu que les cinq nouvelles (sur les vingt qui formaient le projet de base) écrites pendant le XIXe siècle. L’anthologie complète dort toujours dans nos tiroirs.
Quel regard portez-vous sur l’évolution du vampire en littérature ces dernières années ?
Un regard morne. Sans vouloir verser dans le jeu de mots douteux, le vampire est devenu exsangue, sucé par son succès. En 2003, Jean Marigny terminait son monument (Le Vampire dans la littérature du XXe siècle, Paris, Honoré Champion) sur des considérations plutôt pessimistes concernant l’avenir du vampire en littérature. Il a survécu, pourtant, mais à quel prix ! D’un côté, il est entré dans l’écurie « gore » qui rime fort bien avec « j’abhorre ». Il serait peu utile de comparer le charme de Carmilla et ces flots de tripes, de viscères, de déjections qui s’accumulent dans certaines productions récentes – lesquelles privilégient d’ailleurs les zombis (plus sanguinaires, par nature, que les goules), les vampires ou les loups-garous. De l’autre, s’agite un vampire de pacotille, tellement sucré qu’il déchaînerait une crise mortelle chez un diabétique. Inutile de citer les titres de romans ou de films à la guimauve derrière lesquels se profile l’ombre vaporeuse de Stephenie Meyer, la papesse du mouvement. Je laisse la parole, désabusée, à un autre de mes collègue (ami, lui aussi) : « Après le Coca-Cola light et la nourriture allégée, l’oncle Sam semble avoir inventé les vampires niais, bios, sans crocs, sans aura et sans saveur. » [Extrait de : Alain Pozzuoli, La Bible de Dracula ; Dictionnaire du vampire, Paris, Le Pré aux clercs, 2010]. On me pardonnera de préférer les crus de la Romanée-Conti à la piquette de raisin – en plus enrichi de sucre.
Quelles sont vos premières et dernières rencontres avec un vampire (littéraire et / ou cinématographique) ?
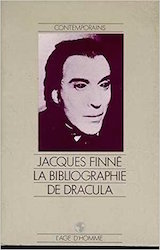 Je crois avoir partiellement répondu à ces questions. Annette Stroyberg porte une lourde responsabilité dans mes amours vampiriques, et la traduction intégrale de Dracula, bien des années plus tard, m’a fait bifurquer vers ces sentiers rouges. Il en reste quelques traces, par exemple avec La Bibliographie de Dracula – qui présente le défaut de n’importe quelle bibliographie : dès qu’elle sort de presse, elle a vieilli. Comme ce bouquin remonte à 1986, si vous songez à la logorrhée de romans et de nouvelles parus depuis lors, il est inutile de souligner combien celle-ci a vraiment vieilli. Une nouvelle édition serait la bienvenue, mais la maison qui a publié l’ouvrage ne veut pas en entendre parler. Il en va de même pour le « Précis de littérature vampirique » paru dans Visages du vampire, en 1999. Depuis, j’ai un peu pris mes distances avec le thème. Quand le vampire est devenu un sujet de recherches aussi courant que Balzac, Stendhal ou Zola, j’ai tourné les yeux dans d’autres directions. Aujourd’hui, à part les goules dont nous avons parlé, je cultive mon petit jardin d’écrivains victoriennes qui ont marivaudé avec le surnaturel.
Je crois avoir partiellement répondu à ces questions. Annette Stroyberg porte une lourde responsabilité dans mes amours vampiriques, et la traduction intégrale de Dracula, bien des années plus tard, m’a fait bifurquer vers ces sentiers rouges. Il en reste quelques traces, par exemple avec La Bibliographie de Dracula – qui présente le défaut de n’importe quelle bibliographie : dès qu’elle sort de presse, elle a vieilli. Comme ce bouquin remonte à 1986, si vous songez à la logorrhée de romans et de nouvelles parus depuis lors, il est inutile de souligner combien celle-ci a vraiment vieilli. Une nouvelle édition serait la bienvenue, mais la maison qui a publié l’ouvrage ne veut pas en entendre parler. Il en va de même pour le « Précis de littérature vampirique » paru dans Visages du vampire, en 1999. Depuis, j’ai un peu pris mes distances avec le thème. Quand le vampire est devenu un sujet de recherches aussi courant que Balzac, Stendhal ou Zola, j’ai tourné les yeux dans d’autres directions. Aujourd’hui, à part les goules dont nous avons parlé, je cultive mon petit jardin d’écrivains victoriennes qui ont marivaudé avec le surnaturel.
Pour vous, comment peut-on analyser le mythe du vampire ? Qu’est-ce qui en fait la pérennité ?
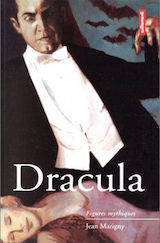 Dans un numéro de la revue Autrement, consacré aux vampires (sous la tutelle de Jean Marigny), je montrais que le vampire constituait sans doute le plus riche des thèmes littéraires de l’humanité puisqu’il cumulait les trois mythes les plus riches de la littérature : le Hollandais volant, toujours obligé de mener une certaine existence, qu’il le veuille ou non, Faust, à la recherche de la jeunesse prolongée, et Dom Juan – qui résiste à un vampire, à Dracula, souvent incarné à l’écran, d’ailleurs, par des bellâtres diaphanes ? Outre cette pluralité thématique, le vampire constitue une réponse à la question qui nous frappe toutes et tous, un moment donné de notre existence : que se passera-t-il après ? Est-ce la dissolution complète, la décomposition et le retour à la terre ou existe-t-il un autre genre de vie post mortem ? Même si l’on est en droit de ne pas envier l’existence des vampires, force est de reconnaître qu’il constitue une réponse à la question. De leur côté, les religions offrent d’autres réponses, à peine moins rassurantes. Le fantôme résout également le problème.
Dans un numéro de la revue Autrement, consacré aux vampires (sous la tutelle de Jean Marigny), je montrais que le vampire constituait sans doute le plus riche des thèmes littéraires de l’humanité puisqu’il cumulait les trois mythes les plus riches de la littérature : le Hollandais volant, toujours obligé de mener une certaine existence, qu’il le veuille ou non, Faust, à la recherche de la jeunesse prolongée, et Dom Juan – qui résiste à un vampire, à Dracula, souvent incarné à l’écran, d’ailleurs, par des bellâtres diaphanes ? Outre cette pluralité thématique, le vampire constitue une réponse à la question qui nous frappe toutes et tous, un moment donné de notre existence : que se passera-t-il après ? Est-ce la dissolution complète, la décomposition et le retour à la terre ou existe-t-il un autre genre de vie post mortem ? Même si l’on est en droit de ne pas envier l’existence des vampires, force est de reconnaître qu’il constitue une réponse à la question. De leur côté, les religions offrent d’autres réponses, à peine moins rassurantes. Le fantôme résout également le problème.
Avez-vous encore des projets de livres ou séries sur ce même thème ? Quelle va être votre actualité dans les semaines et les mois à venir ?
 Comme je l’ai confessé, j’en ai terminé avec les vampires – en principe. Cette année, je me consacre à deux projets qui accapareront tout mon temps. D’un côté, entre 1993 et 2006, sont sortis trois tomes d’un Panorama de la littérature fantastique américaine ; la maison Terre de Brume compte les rééditer en un seul volume et, bien entendu, il me faut moderniser quelque peu le texte. Par ailleurs, à la fin de l’année passée, j’ai rentré une troisième anthologie de contes fantastiques, inédits en français, et rédigés par des Victoriennes. José Corti compte la sortir au début de 2019. Ensuite… à mon âge, il vaut mieux ne pas regarder trop loin. Je ressens une réelle tristesse à la pensée que je n’écrirai jamais le livre que je rêvais d’écrire, depuis très longtemps, et que j’aurais sans doute intitulé : L’anti-Inquisition. À l’époque où est née cette machine à broyer que fut l’inquisition, on pourrait montrer que des lettrés, faisant montre d’un courage proche de l’inconscience, se sont opposés à celle-ci, pour des raisons de logique, d’humanité ou, même, pour des raisons purement légales. Gianfrancesco Ponzinibio, par exemple, juriste de son état, a décrit toutes les irrégularités de procédure sur lesquelles l’inquisition se basait dans sa chasse aux sorcières. Ces chercheurs courageux, que l’on peut très bien comparer aux résistants de la deuxième guerre mondiale, prenaient des risques énormes qui, souvent, les ont menés au bûcher – encore heureux si leurs ouvrages polémiques n’ont pas brûlé en même temps qu’eux. Si un chercheur se sent capable de mener ce projet à bien, je lui envoie volontiers mes notes. Qu’il soit prévenu : j’espère qu’il aime les voyages. Le traité de Ponzinibio, par exemple, n’existe plus qu’en un seul exemplaire, soigneusement gardé à la Marciana de Venise.
Comme je l’ai confessé, j’en ai terminé avec les vampires – en principe. Cette année, je me consacre à deux projets qui accapareront tout mon temps. D’un côté, entre 1993 et 2006, sont sortis trois tomes d’un Panorama de la littérature fantastique américaine ; la maison Terre de Brume compte les rééditer en un seul volume et, bien entendu, il me faut moderniser quelque peu le texte. Par ailleurs, à la fin de l’année passée, j’ai rentré une troisième anthologie de contes fantastiques, inédits en français, et rédigés par des Victoriennes. José Corti compte la sortir au début de 2019. Ensuite… à mon âge, il vaut mieux ne pas regarder trop loin. Je ressens une réelle tristesse à la pensée que je n’écrirai jamais le livre que je rêvais d’écrire, depuis très longtemps, et que j’aurais sans doute intitulé : L’anti-Inquisition. À l’époque où est née cette machine à broyer que fut l’inquisition, on pourrait montrer que des lettrés, faisant montre d’un courage proche de l’inconscience, se sont opposés à celle-ci, pour des raisons de logique, d’humanité ou, même, pour des raisons purement légales. Gianfrancesco Ponzinibio, par exemple, juriste de son état, a décrit toutes les irrégularités de procédure sur lesquelles l’inquisition se basait dans sa chasse aux sorcières. Ces chercheurs courageux, que l’on peut très bien comparer aux résistants de la deuxième guerre mondiale, prenaient des risques énormes qui, souvent, les ont menés au bûcher – encore heureux si leurs ouvrages polémiques n’ont pas brûlé en même temps qu’eux. Si un chercheur se sent capable de mener ce projet à bien, je lui envoie volontiers mes notes. Qu’il soit prévenu : j’espère qu’il aime les voyages. Le traité de Ponzinibio, par exemple, n’existe plus qu’en un seul exemplaire, soigneusement gardé à la Marciana de Venise.


