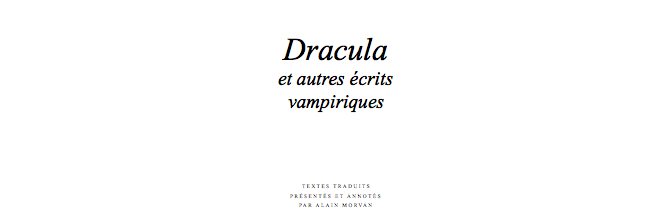Une très grande partie des textes présentés dans cette anthologie dirigée et intégralement traduite par Alain Morvan a beau être déjà présente (par le biais d’autres traductions) sur le site, comment passer à côté de l’entrée conjointe de (notamment) Dracula, Carmilla et Lord Ruthven au sein de la Bibliothèque de la Pléiade ? D’autant plus si l’anthologie propose plusieurs extraits et textes complémentaires que nous n’avons pas eu le loisir, jusqu’alors, de passer au crible. C’est donc à la fois pour sa préface particulièrement dense, les notices d’introduction de tous les classiques que nous connaissons déjà et les inédits (le Florence Marryat était jusqu’à ce jour quasi-introuvable en langue française) que cet opus appelé à devenir une édition de référence va être ici passé en revue.
La préface est à mon sens à considérer comme un des textes d’importances du livre. Alain Morvan, qui coordonne le projet, s’y livre à une passionnante analyse du vampire du XIXe siècle, orientée à la fois sur la genèse de ce dernier et son omniprésence. La rationalité galopante n’est pas pour rien dans cette irruption du buveur de sang, qui matérialise les peurs que la société cherche à éradiquer. Le préfacier fait des écrits vampiriques une excroissance de la littérature gothique, sujet sur lequel il a déjà travaillé pour une précédente (et tout aussi recommandée) anthologie de la Pléiade : Frankenstein et autres romans gothiques. À l’éclairage de cette anthologie antérieure, l’image du vampire sous sa forme littéraire partage de nombreux points communs avec les romans des Radcliffe, Walpole et autres Lewis. Exotisme, Face-à-face avec la mort, decorum, voire certains personnages-clés, comme le chasseur de vampire, dont Alain Morvan va chercher les racines en Viktor Von Frankenstein. Son analyse, qui remonte aux premières créatures proto-vampiriques de la Rome et de la Grèce antique, montre également de manière détaillée comment la chose écrite, en incorporant les mythes passés, est parvenue à donner vie à cet agrégat qu’est le vampire. Au fil de son approche, l’auteur abordera l’ensemble des constituantes de la créature telle que convoquées dans les récits du XIXe, rejoignant Jean Marigny dans son idée d’une « corrélation entre la littérature vampirique et le malaise de la civilisation ». Une dynamique qui ne s’est pas arrêtée avec les textes de cette époque, tant on peut l’appliquer aux nouvelles et romans du XXe, puis du XXIe siècle. À noter également un passage en revue (quasi incontournable) des figures historiques qui ont imprégné l’image du vampire littéraire[ref] À ce titre, je suis récemment tombé sur un article de Duncan Light : « The Status of Vlad Tepes in Communist Romania: A Reassessment », qui tend à minorer l’aura du voïvode dans la Roumanie de Ceaucescu (contrairement à ce que peuvent en dire Raymond McNally et Radu Florescu)[/ref].
Pour en revenir aux textes vampiriques, le premier que reprend l’anthologie est donc le «Christabel» de Samuel Taylor Coleridge. Initialement rédigé en deux parties, l’une datée de 1797, l’autre de 1800, ce poème est pour autant incomplet. Il n’en est pas moins un des plus connus de son auteur, sans doute par son appartenance au corpus de la poésie romantique qui met en scène la figure du vampire. Et si le mot n’est jamais convoqué, ni même la morsure, il y a en effet dans ce texte plusieurs éléments fondateurs, à commencer par la tension sexuelle entre les deux personnages féminins. Pour autant, l’impossibilité de Géraldine de traverser le seuil sans l’aide de Christabel est à mon sens tout aussi intéressant, sans même parler de la métaphore animale qu’utilise Coleridge (le personnage étant ici comparé à un serpent). Dans l’introduction, Alain Morvan explicite certains choix de traductions relatifs à ces poèmes : la sonorité et la rythmique étant ici privilégiées à la rime. La notice du texte va bien au-delà, analysant la manière dont celui-ci s’intègre dans la biographie de Coleridge, voire dans le corpus des œuvres vampiriques fondatrices. Le poète n’est-il pas cité dans Dracula, par l’entremise de «The Rime of the Ancient Mariner» ? La part saphique du texte n’a-t-elle pas inspiré Le Fanu pour son Carmilla ?
Second texte mis en lumière, Le Vampire de John Polidori. Sorti en 1820, il est présenté par l’anthologiste à la fois comme propulsé par la littérature gothique et comme le premier acte (pour ce qui est de la prose) de son prolongement qu’est la fiction vampirique. Polidori va en effet poser certains tropes du genre, à commencer par la morsure et la photophobie, et convoque pour la première fois une partie du bestiaire. Mais il est aussi sous le patronage d’Ann Radcliffe et de ses pairs, lorsqu’il évoque l’étrangeté – voire le surnaturel -, la peur, le suspens, la menace qui plane sur des personnages féminins sans défense et un intérêt pour ce qui est archaïsant. C’est par ailleurs un texte important pour les littératures de l’imaginaire, en cela que sa genèse recoupe celle d’un autre chef d’œuvre du genre : le Frankenstein de Mary Shelley, avec lequel il partage quelques caractéristiques, qui se cristallisent autour du personnage du Lord-Vampire. L’édition sur laquelle se base Morvan (qui attribuait le texte à Byron) intègre une lettre, accolée à un avertissement de l’éditeur, qui en brouille quelque peu les pistes quant à l’initiative de publication. Mais la part rajoutée par l’éditeur fait aussi le pont avec le vampire pré-littéraire, convoquant l’anecdote du vampire Arnold Paul. Un récit qui s’avère donc incontournable, et reste passionnant autant pour ce à quoi il donne naissance que par sa genèse, qui n’a cessé de donner vie à des textes autour de ce qu’on peut appeler « l’épisode Diodati ». Sachant que le roman a d’emblée donné lieu à une descendance, à sa sortie, notamment en France, où on peut considérer qu’il a lancé la vogue des textes sur le sujet (Infernaliana, «La Dame Pâle», «La Morte Amoureuse»…)
Afin de rendre à César ce qui appartient à César, Alain Morvan intègre à la suite du Polidori le fameux «Fragment of a Novel» de Lord Byron qui a servi de matrice au roman de Polidori. Si le texte a été publié du vivant du poète anglais, ce dernier n’a pas apprécié que son éditeur ait pris l’initiative de le proposer sous forme reliée, même si en complément du poème en prose «Mazeppa». L’anthologiste voit en Darvell, le personnage central du texte un moyen pour Byron de faire un plaidoyer de sa propre personne. Mais Morvan pointe un autre élément d’intérêt du Fragment, la référence à la divinité gréco-romaine Cérès-Déméter. Difficile de ne pas penser à Dracula en tombant sur le passage concerné, ce en quoi l’auteur de la notice voit une preuve de la cohérence des récits vampiriques qui sont nés dans la continuité de la période gothique.
Publié pour la première fois en 1872, Carmilla est comme on pouvait s’y attendre au programme de ce volume de La Pléiade. La novella de Le Fanu est à plus d’un titre le terreau le plus évident du roman de Stoker, servant de jonction avec les textes de la première moitié du XIXe siècle anglais. La notice ne néglige pas de revenir sur la biographie de l’homme de lettre irlandais, et l’influence qu’a pu avoir la mort de sa femme sur la dimension macabre de sa production d’après 1858. Eu égard à son œuvre abondante autant que par cette attirance pour le morbide, Alain Morvan fait de Sheridan Le Fanu un digne héritier de la littérature gothique. On retrouve d’ailleurs dans son Carmilla la figure de la femme persécutée. Mais le romancier et nouvelliste s’adresse aussi directement à l’esprit de son temps. Comme Maurice Lévy (cité par le directeur d’ouvrage) l’avait écrit en substance : avec Carmilla, Le Fanu cherchait à inquiéter le lecteur victorien, à le faire sortir de sa niaise assurance. La relation sexuelle ambiguë qui se met en place entre Laura et Carmilla va clairement dans ce sens, la vampire pouvant être considérée comme une sorte de matérialisation des pulsions refoulées de la jeune femme. Et à compulser le roman, on ne peut qu’avoir l’intuition que Stoker a subi son influence, tant certains de ses personnages (Hesselius, doublé de Vordenburg, sont des Van Helsing en puissance) semblent y puiser. Relire ce texte est toujours un plaisir. À mon sens, c’est un de ceux qui exploitent le mieux la métaphore et la suggestivité que dégage le vampire.
Texte suivant du recueil : Dracula. Que dire sur ce roman qui n’aurait déjà été dit ? Alain Morvan propose de revenir sur certains des écrits de l’auteur irlandais dans lesquels on trouve les prémices de son ouvrage phare, à commencer par «L’Enterrement des Rats» (sorti en 1896, un an avant Dracula), qui préfigure selon lui la hiérarchie animale qui prévaut dans le roman de 1897. Mais il ne néglige pas de montrer à quel point le sang pourrait être classé comme un personnage à part entière du roman, tant la pureté de ce dernier (dans les discours de Dracula quand il rappelle les origines des siens, mais on pourrait aussi parler de l’appétence de Lucy pour celui des jeunes enfants -) est centrale dans la trame. Dracula, c’est à n’en pas douter le texte qui digère tous ceux qui l’ont précédé, et pose de manière durable les principaux tropes de la littérature ès vampire qu’on connaît encore aujourd’hui. En premier lieu un roman gothique, car il respecte une large part des codes du genre.L’architecture des lieux – et leur ancienneté – est importante, la peur est omniprésente, le sublime s’impose quand la tempête fait rage. Mais aussi les jalons d’un renouveau, lorsqu’il ancre son récit dans la modernité, en faisant notamment appel à la technologie quand il met en scène la polyphonie de sa narration.
Antépénultième texte proposé, sans doute le moins connu (s’il a déjà été traduit en français, c’est uniquement sous forme de feuilleton, qu’avait initialement prévu de rééditer Jean-Daniel Brèque au sein de sa collection Baskerville). Un deuxième roman de vampire, sorti lui aussi en 1897 ! Mais le texte de Florence Marryat diffère en de nombreux points de celui de Stoker. Il aborde son sujet sous l’approche psychique (ce que l’anthologiste appelle le vampirisme à sec), et se mâtine de comédie de mœurs dans sa première partie, quand il distille progressivement l’étrange dans sa galerie de personnages. Un étrange dont certains aspects sont à n’en pas douter influencés par la littérature gothique (le père de l’héroïne est présenté comme un savant fou, et sa mère comme une prêtresse vaudou). Mais c’est aussi un roman qui fait de l’hérédité un de ses thèmes centraux, à commencer par les origines du mal dont est atteint Harriet Brandt. Les repères biographiques nous apprennent quant à eux plusieurs éléments intéressants sur la femme de lettres, notamment sa participation au texte choral The Fate of Fenella, projet initié où l’on retrouve des noms comme ceux de Arthur Conan Doyle (qui a aussi abordé plusieurs fois le thème vampirique) et Bram Stoker (!). Marryat est une autrice qui mérite d’être remise à l’honneur, dont la production littéraire touche à tous les genres, et qui a su à son époque s’imposer dans un milieu essentiellement masculin.
Il faut enfin prendre en compte les appendices comme un bloc à part entière du livre, car proposant deux extraits de textes importants dans la genèse du vampire. Le premier d’entre eux, «Thalaba le Destructeur» (1801) de Robert Southey est considéré comme la première utilisation marquante du mot vampire dans la langue anglaise. Le passage choisi est court (à peine 50 vers) mais il est accompagné par les notes de l’auteur, qui montrent, comme le souligne le traducteur, à la fois le souci du détail de Southey et son intérêt pour le macabre. De mon point de vue, la deuxième note, qui propose un tour d’horizon de quelques textes vampiriques avant l’intronisation de la créature dans la fiction fait également le lien avec le vampire folklorique. On peut aussi pointer l’influence qu’a pu avoir ce texte sur le Giaour de Byron (même si le Lord n’appréciait pas son compatriote poète), et le fait qu’il ait été lu durant le séjour de Shelley & Co à la Villa Diodati. À nouveau, il s’agit d’une femme vampire, qui périra par le pieu (là aussi, c’est sans doute une des premières utilisations du trope en littérature). Deuxième et dernier texte de ces appendices, «Giaour» (1813) de Lord Byron. Preuve que l’intérêt de l’auteur pour la figure du buveur de sang ne date pas de son jeu littéraire avec Shelley, Polidori et les autres, ce texte puise dans l’imaginaire méditerranéen («Giaour» est un mot qui décrit les infidèles) d’un côté, et assène en quelques lignes les caractéristiques du vampire qui basculeront bientôt dans la prose.
Alain Morvan propose également une courte, mais passionnante notice qui explicite la constitution du présent ouvrage. Dans la lignée de son précédent travail, Frankenstein et autres romans gothiques, l’anthologiste et traducteur a choisi ici de se focaliser sur la production des Îles britanniques, ce qui explique l’absence de texte pourtant important dans la genèse du genre, comme «La Morte Amoureuse». Mais cette notice est également le lieu où l’auteur détaille certains de ses choix de traduction, principalement pour Dracula. Le roman de Stoker a été maintes fois traduit en français, et certaines finesses ne sont accessibles qu’à ceux qui ont lu le texte en anglais. À commencer par les interventions de Van Helsing (ce que mettait déjà partiellement en avant Jacques Sirgent lorsqu’il évoquait les apports de sa propre traduction), dont la qualité d’expression est variable, autant par ses origines hollandaises que par la diversité des protagonistes qui rapportent ses propos. Alain Morvan pointe aussi certaines difficultés rencontrées dans les traductions des autres œuvres retenues, notamment les textes versifiés, et la nécessité d’opérer un choix entre le fond et la forme.
Frankenstein ayant été intronisé dans la Pléiade en 2014, Dracula devait à un moment ou un autre subir le même sort. C’est donc chose faite avec ce 638e opus de la Bibliothèque de la Pléiade, qui explore la genèse du vampire littéraire (anglophone) de la poésie à la prose, jusqu’à l’orée du XIXe siècle. Un ouvrage appelé à devenir une référence, tant les notices qui s’adossent à chacun des textes apportent des éclairages quant à leur position dans l’histoire littéraire, et montrent la constitution progressive d’un corpus qui n’a depuis cessé de se réinventer autour de la figure du vampire. Avec cette « suite » à son travail déjà impressionnant consacré à la littérature gothique, Alain Morvan enfonce le clou et montre que la dynamique créée par les textes qu’il a explorés dans sa précédente anthologie pour la même collection s’est poursuivie tout en donnant naissance à ce qu’on en vient parfois à considérer comme un genre à part entière : la littérature vampirique. D’une certaine façon, c’est aussi la reconnaissance d’une figure de l’imaginaire par trop décriée, qu’on a trop tendance, depuis quelques années, à vouloir édulcorer, voire à dénaturer.