La Ville-Vampire (1875) est le troisième récit « vampiral » (l’adjectif est de Féval lui-même) de cet auteur prolifique. Après avoir d’abord modernisé la figure du vampire, il s’emploie ici à une parodie de l’écriture de la romancière Ann Radcliffe, employant l’astuce d’un récit-cadre où il est question qu’une confidente de l’écrivaine raconte une histoire entendue auprès d’Ann Radcliff elle-même, qui aurait vécu et été inspirée par cette aventure dans sa future oeuvre narrative. Paul Féval, pour tout effet de réel, rapporte ces propos qu’on lui aurait confiés afin qu’il les publie sous son nom. L’histoire centrale, qui est la principale, commence de manière assez classique par l’enlèvement d’un futur marié (qui est traîné jusqu’en Illirie… où sinon ? Les vampires sont de l’Est, tout le monde le sait…) par un vampire, dit M.Götzi, possédant des caractéristiques assez inhabituelles. Le tout devant aller (mais non finir encore), vers la destruction dudit vampire, on découvre à l’occasion que cette espèce possède sa cité sur Terre.
Ce texte est un pastiche, et réussi, mais c’est aussi un bon roman, imaginatif, parfois cocasse, grotesque, échevelé, original, même si le dénouement laisse un peu sur les dents (les canines, tant qu’à faire), ce qui est justement dû à l’aspect parodique de la trame.
Les lecteurs en recherche de variations inédites autour de la figure du vampire ne pourront pas être déçus. Poppy Z Brite, la fée de l’absinthe, a peut-être puisé son inextinguible vert dans les lignes de La Ville-Vampire : le vert, c’est la couleur du vampire, celle où baigne l’aventure et qui donne une esthétique surnaturelle. De la chair et des yeux du vampire, en effet, émane une lueur verte, qui va jusqu’à pousser Féval à écrire qu’il ressemble, dans le noir, à une bouteille verte éclairée de l’intérieur.
D’autres détails incongrus concernent le vampire : il possède un aiguillon très pointu au bout de la langue, qui lui permet de percer un trou dans la chair ; il se colle ensuite comme une sangsue pour aspirer le sang. Il ne peut en principe jamais mourir, mais comme il peut se prendre de super mandales, il a une serrure sur sa poitrine, à hauteur de son cœur, qu’une clé spéciale peut pénétrer afin de « remonter » le vampire, qui retrouve ainsi une santé de fer. Pour traverser l’eau, il lui suffit de se mettre à plat-dos, les pieds en avant. La cendre de coeur de vampire lui cause un éternuement qui le fait violemment (et fatalement) exploser.
Son animal fétiche est l’araignée, mais il peut prendre la forme qu’il souhaite. Mieux, il sait se fondre avec les éléments ou encore peut se dédoubler, à condition de récolter auparavant des victimes-esclaves. En effet, chaque double de lui-même est une de ses anciennes victimes qu’il s’est attachée et à laquelle il peut faire prendre la forme qu’il souhaite, chacune étant un douzième de lui-même. C’est ainsi que M. Götzi, le vampire de l’histoire, fait apparaître dès qu’il le veut : un sale gosse tenant un cerceau, une vieille femme chauve, un perroquet, un chien, qui eux-mêmes ont le pouvoir de se dédoubler, mais qui se fusionnent de nouveau avec le vampire à son signal.
Reste encore ce qui vaut le titre de l’histoire, la cité des vampires (idée reprise dans Tuer les morts de Tanith Lee), décrite avec tout le grandiose qui lui est dû.

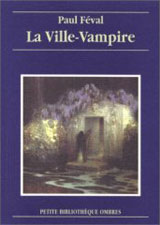

La ville-vampire est une lecture très ancienne dans mes souvenirs d’amateur de littérature vampirique. Pour autant, il m’aura fallu l’occasion d’une relecture à l’occasion d’une future postface pour que je me décide enfin à poser par écrit mon ressenti sur le court roman de Paul Féval. Sorti en 1875, soit après Le Vampire de Polidori et le Carmilla de Le Fanu, mais bien avant le Dracula de Stoker, le roman de Féval n’est donc pas contraint par le poids du roman de l’auteur irlandais, qui a (aidé par le cinéma) fortement orienté (pour ne pas dire contraint) les auteurs qui l’ont suivis. Ici, le romancier propose a contrario une vision réellement originale de la chose vampirale. Car s’il intègre des caractéristiques déjà présentes dans les nouvelles et romans du genre existants à son époque (essentiellement le rapport au sang), Féval y ajoute de très nombreuses touches de sa propre invention, tour à tour absurdes, poétiques ou rocambolesques.
Ainsi, ses vampires dégagent une lueur verte inimitables, sans doute à rattacher à la symbolique de la mort. Ses créatures sont également dotées d’une langue terminée d’une aiguille, par laquelle elles prélèvent le sang de leurs victimes. Elles sont également à même d’absorber leurs proies, ce qui leur permet par la suite de se scinder en plusieurs entités, voire de se dédoubler. Enfin, si elles peuvent être blessées, elles ont la possibilité de faire restaurer leur force, via le mécanisme à clé situé vers leur coeur.
Mais c’est bien évidemment la Ville-Vampire, Sélène, qui représente l’apport le plus impressionnant de Féval à la figure du vampire. Le feuilletoniste imagine ainsi une citée invisible (ou presque) aux yeux des hommes où les vampires peuvent se réfugier. Une ville-nécropole où le temps s’écoule de manière différente, à l’architecture titanesque, qui renferme une population à tiroir (vu le pouvoir détaillé précédemment). Comme le relève Senhal dans sa chronique, on serait tenté de faire le parallèle avec Ghyste Mortua, la ville en quête de laquelle se trouvent les personnages de Tuer les Morts de Tanith Lee.
Ce à côté de quoi j’étais passé lors de ma première lecture, c’est également le travail de pastiche de l’oeuvre d’Ann Radcliffe que réalise ici Féval. Le style de l’auteure est ainsi convoqué plusieurs fois par l’entremise de la ville femme qui lui raconte l’histoire, de même que le déroulement du récit se raccroche à l’oeuvre de la romancière… tout en réécrivant sa vie à la manière de ses propres textes… en expliquant au passage l’origine de certains lieux des romans phares de Radcliffe. Un exercice de style qui sous-tend d’un bout à l’autre le roman, jusqu’à cette fin toute en hésitation, si emblématique de la maîtresse du Roman Gothique.